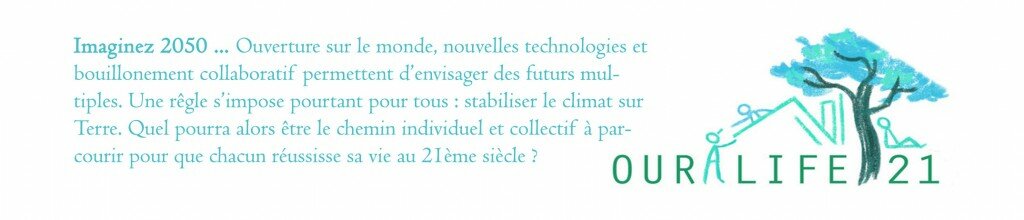
L’ampleur des transformations actuelles aux plans économique, technologique, social, écologique, comme au niveau des relations internationales, fait entrer dans une période de l’histoire profondément différente des deux siècles précédents. Cela rend nécessaire de multiples mutations difficiles à intégrer par les populations.
Celles-ci s’avèrent d’autant plus difficiles à mettre en œuvre qu’elles sont à opérer dans un contexte de crise économique et sociale. L’obtention de l’adhésion des populations et de leur participation active aux transitions est donc centrale pour la réussite de la lutte contre le changement climatique. La démonstration globale de la faisabilité technique et économique des solutions ne suffit plus. Il est essentiel que les personnes puissent situer les transitions et les actions qu’elles auront à réaliser par rapport à leurs aspirations de réalisation personnelle et de bien-être. Or les exercices de prospective, les négociations internationales et les politiques publiques se focalisent exclusivement sur des scénarios globaux et ne s’attachent pas à impliquer directement les personnes. Tout va se jouer dans la capacité à construire une cohérence entre les évolutions générales de la société, les transitions globales nécessaires et les transformations de modes de vie personnelle. Dès lors, le programme Our Life 21 s’inscrit dans les principes qui suivent :
- La prégnance des questions éthiques
L’émergence de principes éthiques et moraux à vocation universelle dans des projets de société est un aspect important à prendre en compte dans la transition. Et ce pour respecter les objectifs environnementaux. Ce que souligne la difficulté des négociations internationales sur le climat et le développement durable, c’est que la somme des intérêts nationaux ne donne plus l’intérêt général de l’humanité toute entière. L’objectif de règles éthiques renforcées serait d’écarter la violence, d’assurer la cohésion sociale dans le respect attentif des limites de la planète afin de réduire les inégalités. D’un point de vue anthropologique, il est clair que les grandes religions et les philosophies ont depuis plusieurs millénaires assuré cette fonction fondamentale de définir les règles collectives en insistant sur les conditions de la maîtrise de la violence ainsi que sur les voies et sens de la réussite des vies individuelles. L’avancée vers un développement durable en appelle à de nouvelles valeurs.
- S’insérer dans une citoyenneté globale
Les multiples processus de mondialisation actuels, qu’ils touchent à la production industrielle, aux échanges économiques et monétaires, à la gestion écologique de la planète, à la communication et à la circulation des informations, tous exigent en contrepartie que le citoyen se situe dans un scénario désirable de réussite globale de sa propre vie s’intégrant dans un projet collectif commun à l’humanité toute entière. Cela est particulièrement important dans les domaines de l’énergie, du climat et des grands enjeux environnementaux qui sont avant tout de portée globale planétaire, et donc largement éloignés des perceptions et préoccupations quotidiennes individuelles.
Cela implique un progrès politique : construire une citoyenneté et une identité planétaires qui viennent s’ajouter à celles existantes (locale, nationale, européenne, de genre, d’appartenance sociale…). Il faut donc s’inscrire dans une perspective positive à la fois collective et individuelle, apte à donner sens au processus de transition.
Notre futur, individuel et collectif est à la fois rempli de promesses et d’incertitudes… Pourtant la projection de chacun dans une vie réussie est la condition essentielle d’une transition écologique et sociale acceptée et non subie. L’opinion publique est à ce titre en demande de propositions concrètes, vivantes, palpables pour un avenir réussi.
Comme exprimé précédemment, il n’y aura vraisemblablement guère de succès possible de la conférence des Nations Unies de Paris sans un soutien réel des opinions publiques des différents pays concernés. Or, malgré l’existence de nombreux travaux prospectifs, force est de constater qu’il n’y a jamais eu d’explicitation officielle des modes de vie possibles pour chacun dans un monde sobre en carbone et inscrit dans une trajectoire de développement durable adaptée au contexte de chaque pays.
Pour mettre les modes de vie, et in fine notre modèle de développement, au cœur du débat, il convient d’affiner la compréhension que nous avons de leur évolution, des vecteurs de transformation vers la sobriété, des progrès technologiques mais aussi sociaux, culturels, organisationnels qui nous font changer… et qui nous donnent envie de changer. Il faut aussi asseoir l’analyse et les propositions sur des bases scientifiques et économiques afin de rassembler les acteurs, politiques, chercheurs, entreprises, ONG et citoyens.
Par « modes de vie », nous entendons ici la prise en compte de fonctions qui structurent notre quotidien : se loger, se déplacer, se nourrir, se vêtir, travailler, se divertir etc. Mais également des valeurs, représentations du monde et de soi qui nous traversent individuellement et qui nous rassemblent, avec leurs dimensions sociologiques, psychologiques et culturelles. Ces usages et valeurs sont conditionnés par un contexte nourri de politiques publiques, et plus généralement d’offres de biens et de services publiques et privées. Si les modes de vie interrogent les choix individuels des personnes, ils sont interdépendants d’un environnement collectif. Aussi, ce que nous entendons par modes de vie, ne se cantonne pas à la seule responsabilité individuelle et fait écho aux modes de faire, de produire et de mener les politiques publiques.
Par voie de conséquence, comme c‘est toujours le cas dans les changements majeurs de civilisation, les modifications des méthodes de production (agricoles, industrielles…) les évolutions technologiques, les transformations de l’organisation des activités productives, l’accès à de nouveaux moyens de transports et de communication transforment profondément aussi bien les mentalités, l’organisation économique et sociale que les structures politiques.
- Réussir la transition énergétique et écologique ainsi que la lutte contre le changement climatique en s’inscrivant dans les temporalités précises
La transition énergétique et écologique doit s’inscrire dans le cadre des objectifs quantifiés de réduction des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre, tel que cela découle des travaux scientifiques, mais aussi selon un calendrier de réalisation contraint pour éviter les impacts négatifs dévastateurs. Concrètement, la transition doit être réalisée pour l’essentiel avant 2050, sinon les quantités de polluants et de gaz à effet de serre émis provoqueront des conséquences irréversibles. Ainsi, dans de nombreux domaines, le milieu du siècle va constituer une échéance décisive. On ne peut réussir cette transition sans l’inscrire très concrètement dans le fil de l’histoire des vies personnelles. Même si cela constitue un horizon temporel perçu comme bien lointain pour l’organisation de la vie quotidienne et la construction des pratiques sociales. Cela implique de resituer la personne au centre des transformations politiques.
- Une vague nouvelle de progrès technologiques
La perspective d’une troisième révolution industrielle, selon les termes employés par Jeremy Rifkin, s’appuie essentiellement sur l’efficacité énergétique, le développement des ressources renouvelables et l’optimisation de la gestion grâce à internet et les nouvelles technologies de communication. Plusieurs variantes de cette orientation sont évidemment perceptibles notamment pour ce qui concerne la place du nucléaire et de l’ingénierie génétique. Si d’autres voies peuvent s’ouvrir en matière de progrès technologique, il faut se poser la question de la possibilité des différents pays d’y accéder notamment à travers des coopérations et des transferts de technologies
- Rendre perceptibles les bénéfices collectifs, notamment en emplois
A l’interface de la transition énergétique et écologique globale et des transitions personnelles, sont aussi indispensables des preuves tangibles de bénéfices individuels et collectifs. Il s’agit notamment de la réduction des dépenses contraintes (qui libère du pouvoir d’achat), de la création d’emplois, de la compétitivité générale de son pays et de son territoire de vie, du maintien de la protection sociale. C’est-à-dire de facteurs qui conditionnent la cohésion sociale et la paix civile. D’ailleurs, la crise économique actuelle exige une réponse en termes de développement endogène en contrepartie des mondialisations économiques, écologiques, technologiques et informationnelles. C’est aussi indispensable pour incarner au développement local les nécessaires transitions au niveau microéconomique et des histoires de vie.
- S’inscrire dans un cadre démocratique et de cohésion sociale
La mondialisation économique et la gestion collective de la planète nécessitent le renforcement d’un cadre politique qui associe tous les peuples ainsi que des règles communes de régulation. Le dernier principe posé est donc de s’inscrire dans une société démocratique, intégratrice qui s’attache à réduire les inégalités et la violence. Cela rejoint la recherche dans la négociation internationale d’un cadre juridique qui assure la confiance du respect des engagements pris. Un cadre juridiquement contraignant constitue une condition de crédibilité et d’efficacité.
Concrètement, on ne peut pas diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sans adhésion et mise en pratique active de la part du citoyen. D’ailleurs, pas seulement pour obtenir un soutien politique dans la négociation, surtout pour la mobilisation de tous ensuite dans la mise en œuvre. Et cela s’applique à tous les pays, développés comme en développement. D’où l’interrogation : comment réduire cette distance entre les objectifs issus des travaux scientifiques, les mutations technologiques à engager, les décisions politiques à prendre et l’implication indispensable des citoyens et des acteurs économiques ?
Un cadre démocratique est ainsi indispensable pour favoriser une dynamique collective de changement à travers un enrichissement des solutions et innovations et la recherche de consensus et d’adhésion à un projet collectif. Avant de privilégier les mesures incitatives ou les mesures de contrainte, l’exigence démocratique suppose l’existence d’un cadre de co-construction, d’un espace de négociation du contrat social. Sans cela, il est clair que les tensions déjà perceptibles dans le monde et au sein des pays feraient basculer dans des logiques conflictuelles voire totalitaires venant en contradiction avec les enjeux écologiques et sociaux. Le respect des limites globales ne pourra pas être obtenu sans contrepartie. Celle-ci devrait être une plus grande intégration du citoyen dans la prise de décision collective.
- La révolution des moyens de communication et les nouvelles opportunités relationnelles
Les rapides progrès des technologies de l’information et de la consommation renforçant les échanges relationnels interpersonnels pourraient permettre de se désengager des impasses du mode de développement actuel pour progresser dans une nouvelle voie d’expansion pour l’humanité fondée sur l’accès à l’autre, à la connaissance et à la culture en minimisant les consommations de matières et les émissions de polluants. Il y a assurément une nouvelle voie d’expansion possible pour l’humanité dans cette direction car la connaissance, la relation à l’autre et la culture ouvre la porte à des infinis.

